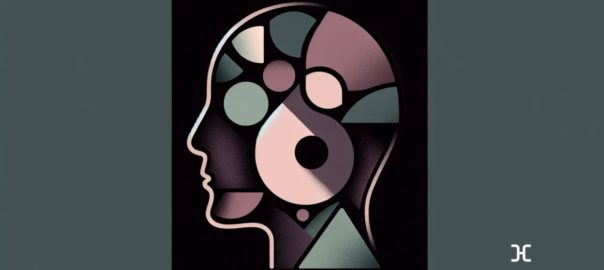Didier Heiderich & Gilles Delanoë – Mars 2025
Une profession exposée à la désinformation
L’agriculture est aujourd’hui au cœur d’une bataille informationnelle. Entre polémiques virales, campagnes militantes et diffusion de contenus biaisés, le secteur doit faire face à une remise en question constante de ses pratiques. Derrière cette désinformation, on retrouve des images sensationnalistes, des narratifs simplistes et des démonstrations pseudo-scientifiques, des études biaisées parfaitement marketées, diffusés massivement sur les réseaux sociaux et régulièrement reprises par la presse.
Le poids des narratifs biaisés
Les attaques contre l’agriculture reposent sur des mécanismes bien identifiés. Des vidéos sorties de leur contexte assimilent systématiquement l’élevage à de la maltraitance animale, les traitements phytosanitaires à des poisons systématiques, et l’agriculture conventionnelle à un modèle destructeur. L’idéologie prend souvent le pas sur les faits, réduisant un domaine complexe à des oppositions simplistes entre « naturel » et « chimique », « paysan » et « industriel ». Les mots font peurs et la peur fait vendre.
La construction d’une défiance artificielle
Un des leviers les plus efficaces de cette désinformation repose sur des démonstrations pseudo-scientifiques, soigneusement mises en scène pour orienter l’opinion publique. Certains influenceurs et médias engagés produisent des tests biaisés visant à prouver la toxicité de certaines substances ou l’infériorité des pratiques agricoles modernes. Ces mises en scène exploitent le manque de connaissances scientifiques du grand public et créent un climat de suspicion généralisée. Hugo Clément en a fait son fond de commerce avec son média Vakita, créant parfois de toute pièce, sur la base d’une information simplifiée, des vidéos et articles polémiques qui amplifient la défiance envers les agriculteurs.
L’impact concret sur le monde agricole
Cette désinformation a des conséquences directes. Elle érode la confiance des consommateurs, influence des décisions politiques parfois déconnectées des réalités du terrain et fragilise la pérennité économique des exploitations. Les agriculteurs, déjà soumis à des contraintes économiques et environnementales fortes, doivent désormais consacrer du temps et des ressources à déconstruire ces narratifs trompeurs.
Admettre les limites et valoriser les efforts
Une communication efficace ne consiste pas à prétendre que tout est parfait. Le secteur agricole, comme toute activité humaine, comporte ses limites et doit en être conscient. Reconnaître les défis et les marges de progrès permet de renforcer la crédibilité du discours. Admettre, par exemple, que certaines pratiques nécessitent des ajustements ou que des recherches sont en cours pour améliorer la durabilité, montre une volonté de transparence et d’amélioration continue.
Les agriculteurs sont engagés depuis des décennies dans des démarches d’évolution, avec des efforts constants pour réduire les intrants chimiques, préserver les sols et optimiser la gestion de l’eau. Mettre en avant ces avancées, tout en acceptant d’expliquer les contraintes et les complexités, est une condition essentielle pour restaurer la confiance.
Vers une communication structurée et proactive
Face à cette situation, la réaction ne peut plus être ponctuelle ou défensive. L’agriculture doit structurer une communication proactive et continue, à l’image de ce que font des communautés comme FranceAgriTwittos. Plutôt que de répondre aux polémiques au cas par cas, il s’agit de prendre les devants en identifiant les enjeux sensibles et en diffusant un flux constant d’informations pédagogiques et factuelles.
Une communication efficace repose sur trois piliers :
- L’anticipation : identifier les sujets sensibles et construire un discours clair avant que les polémiques ne surgissent.
- L’explication rigoureuse : montrer concrètement les pratiques agricoles et expliquer les choix techniques.
- L’engagement direct : dialoguer avec les consommateurs, répondre aux interrogations et corriger les idées reçues sur le terrain du débat public.
L’enjeu d’une reconquête de l’opinion
La lutte contre la désinformation agricole ne concerne pas seulement l’image d’une profession. Elle touche à des enjeux fondamentaux comme la souveraineté alimentaire, la transition agroécologique et la gestion des ressources. Laisser prospérer des récits erronés, c’est prendre le risque de décisions politiques et sociétales inadaptées aux réalités du secteur.
Dans un monde où l’opinion se façonne en quelques clics, le silence n’est plus une option. L’agriculture doit redevenir actrice de son propre récit, en s’appuyant sur des initiatives de terrain, des données rigoureuses et une stratégie de communication structurée. La vérité agricole ne peut se limiter à répondre aux attaques ; elle doit s’imposer par un discours construit, authentique, constant et crédible.
Décrypter et reconstruire, une stratégie pour regagner l’adhésion
Les opinions ne se transforment pas du jour au lendemain. Elles évoluent sous l’influence d’un ensemble de facteurs progressifs, souvent imperceptibles à court terme. Partant de ce constat, la reconquête des groupes d’opinion éloignés ne peut pas se limiter à une simple démonstration de faits ou à un affrontement d’idées. Il s’agit d’un travail de fond, structuré autour du « comment » plutôt que du « pourquoi », une reconstruction patiente des repères qui ont été érodés avec le temps.
Reprendre le fil de l’histoire, remonter aux événements déclencheurs qui ont façonné les perceptions et les méfiances, est une étape essentielle. Ce travail d’analyse ne s’arrête pas aux individus : il concerne l’ensemble des dynamiques collectives et culturelles qui influencent les décisions. Pour comprendre ces mécanismes, il faut changer de perspective, se placer de l’autre côté de la table, identifier les signaux faibles et saisir la logique qui sous-tend la construction d’un raisonnement.
Cette démarche nécessite une véritable ouverture : écouter sans juger, comprendre sans imposer, capter les préoccupations profondes et décrypter la hiérarchie des valeurs qui structurent un point de vue. Il ne s’agit pas de convaincre frontalement, mais de réintroduire une réflexion structurée, de proposer un cadre dans lequel un dialogue devient possible.
La clé réside dans une approche de proximité, menée par des communicants et des acteurs capables d’évoluer dans les référentiels culturels et sociaux des groupes à reconquérir. Cette reconquête exige du temps, de la rigueur et une réelle humilité. Les premiers signes de changement seront imperceptibles, mais il faudra savoir les détecter, les amplifier et les accompagner avec méthode. L’enjeu n’est pas seulement d’apporter des réponses, mais de rétablir un cadre de compréhension commun, pas à pas, pour permettre un retour progressif vers une adhésion raisonnée aux enjeux.